Les travaux de la Commission Bergier, qui accusa la Suisse de responsabilité dans les crimes du IIIe Reich, ont fait l’objet de nombreuses critiques au cours de la décennie. L’abondante littérature parue depuis permet aujourd’hui de ranger le rapport Bergier au rayon des œuvres de circonstance et de poser un tout autre regard sur cette période historique.
On sait que la très officielle « Commission indépendante d’experts Suisse – Seconde Guerre mondiale » (CIE), dite Commission Bergier, du nom de son président, a cherché à accréditer la thèse d’une responsabilité de la Suisse dans l’accomplissement de l’Holocauste par le IIIe Reich. Dans son premier rapport sur les réfugiés de 1999, tellement bâclé qu’il a fallu le « revoir » et le « corriger » de fond en comble, on trouvait cette petite phrase conclusive : « En créant des obstacles supplémentaires à la frontière [en août 1942], les autorités suisses ont contribué —intentionnellement ou non— à ce que le régime national-socialiste atteigne ses objectifs ». Infamante pour notre pays et ses autorités de l’époque, ce grief sera repris jusque dans le Rapport final présenté en mars 2002 (voir document joint au bas de cette page) : « En fermant la frontière de plus en plus sévèrement, en remettant à leurs poursuivants des réfugiés surpris lors de leur passage clandestin, et en s’accrochant trop longtemps à cette attitude restrictive, on livra des êtres humains à un destin tragique. Dans ce sens, les autorités de la Suisse ont réellement contribué à la réalisation de l’objectif des nationaux-socialistes ». La question de savoir si cette prétendue contribution des autorités suisses à la réalisation des objectifs nazis était intentionnelle n’est alors plus posée. On constate simplement l’existence objective de cette contribution.
Lorsqu’on demande à M. Jean-François Bergier, en décembre 1999, pourquoi les auteurs du rapport ont presque entièrement gommé le contexte international de l’époque et renoncé à toute comparaison avec le comportement des autres États neutres, il invoque le mandat confié par les autorités, qui n’aurait pas prévu de tels développements, et ajoute que, de toute façon, ce genre de comparaison n’aurait pas été à l’avantage de la Suisse !
Le Rapport final consacre à cette question à peine quatre pages dans son chapitre traitant des réfugiés et de la politique d’asile. Les quelques lignes concernant les Etats-Unis et la Suède constituent un modèle de désinformation ; ce que relèvera, preuves à l’appui, le Cahier de la Renaissance vaudoise [1] consacré à ce thème, critiquant par ailleurs l’ensemble du Rapport final pour sa « vision biaisée et idéologisée de la réalité, très en deçà de ce que l’on est en droit d’attendre d’historiens dignes de ce nom ».
Le « front du refus »

D’autres ouvrages vont aussi remettre en cause la démarche et les conclusions du rapport Bergier [2]. L’historien affiche alors une attitude méprisante à l’égard de ce « front du refus » dans des Entretiens qu’il accorde à deux historiens et journalistes favorables à ses thèses : « Il est probablement normal dans un pareil cas qu’un tel pavé [le Rapport final] mobilise d’abord un front du refus. Mais il va bientôt s’éteindre. C’est la réaction spontanée, épidermique, de ceux qui n’acceptent pas de faire le deuil d’une image mythique et qui ont entrepris d’écrire, ou de faire écrire par des nègres, ces livres de réfutation. Après eux vient le front du soutien, de la réflexion critique et sérieuse » [3].

Il serait facile de rétorquer que les « nègres » du Groupe de Travail Histoire Vécue ou du Cahier de la Renaissance vaudoise n’ont rien coûté aux contribuables, contrairement aux dizaines de collaborateurs de M. Bergier, qui n’a lui-même pratiquement pas écrit une ligne en dehors de certains chapitres du Rapport final qu’il a dû corriger ou réécrire. On se bornera ici à relever l’absurdité de l’affirmation selon laquelle le travail de remise en cause des conclusions du Rapport final devrait bientôt prendre fin. Le rapport Bergier posant problèmes, ces derniers ne cesseront d’être débattus, selon des modalités et dans des tonalités diverses.

Au moment même où paraissaient ces étranges Entretiens, l’historien américain Stephen P. Halbrook publiait The Swiss and the Nazis (Havertown, 2006), plaidoyer en faveur de la politique des autorités suisses face à la menace nazie que la NZZ (24 juin 2006) a qualifié de « monument à la mémoire de la génération du service actif », cependant que le spécialiste de l’or et des questions monétaires Philippe Marguerat remettait les pendules à l’heure dans son domaine de prédilection avec L’économie suisse entre l’Axe et les Alliés, 1939-1945 (Alphil, 2006). L’année suivante, Jean-Jacques Langendorf publiait sa somme sur l’Histoire de la neutralité (Infolio 2007), qui remet aussi en cause certaines conclusions du Rapport final.
La neutralité suisse étudiée dans une perspective comparatiste
Aujourd’hui, c’est un historien états-unien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Herbert R. Reginbogin, qui comble l’une des lacunes les plus graves du rapport Bergier en examinant la neutralité suisse dans une perspective comparatiste. Dans Guerre et neutralité – Les neutres face à Hitler, ouvrage paru initialement en allemand sous le titre Der Vergleich et traduit en français par Jean-Jacques Langendorf, avec l’appui financier du Groupe de Travail Histoire Vécue, cet ancien élève de l’historien bernois Walther Hofer met en lumière des faits passés sous silence et des distorsions de l’histoire, mais aussi des éléments complexes et des contraintes en fonction desquels les autorités de l’époque ont dû prendre leurs décisions. La Confédération n’a cessé d’agir selon le principe constamment répété par le chef du Département de l’économie publique, le conseiller fédéral Walther Stampfli : « Vivre d’abord, philosopher ensuite », ou encore : « Ce que diront nos descendants ne m’intéresse absolument pas. Ce qui m’intéresse beaucoup plus, c’est ce que dirait la génération actuelle si elle n’avait pas de charbon et rien à manger ! ».
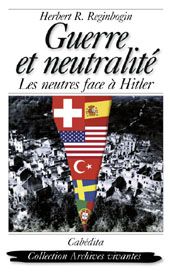
Reginbogin montre ensuite comment d’autres pays —aussi bien neutres que belligérants— ont essayé d’utiliser la neutralité comme moyen d’imposer leurs objectifs ou comme réponse aux possibilités offertes et aux dangers qui menaçaient. Il s’est focalisé sur les États-Unis, neutres jusqu’en 1941, l’Espagne, le Portugal, la Suède, la Turquie et un pays vaincu mais non occupé, la France de Vichy. Au terme d’une enquête approfondie, s’appuyant notamment sur des documents états-uniens déclassifiés, il conclut que la Suisse est à coup sûr le pays neutre qui a le mieux préservé sa position et agi le plus conformément au droit des gens. Certaines conclusions du rapport Bergier et des deux rapports Eizenstat en prennent un coup et l’effrayant déséquilibre dans le traitement des neutres par les Alliés au lendemain de la guerre apparaît sous un jour bien cru. La Suède n’est-elle pas régulièrement présentée comme le modèle dont la Suisse aurait dû s’inspirer ? Sa neutralité est pourtant celle qui a permis aux troupes allemandes de transiter massivement par son territoire et d’y installer des dépôts, à la Kriegsmarine d’utiliser les ports du pays, à la Luftwaffe de se servir des aérodromes, sans oublier les livraisons massives de roulements à billes et de minerai de fer. Deux Suédois, l’historien Tobias Berglund et le journaliste Niclas Sennerteg, viennent d’ailleurs de jeter un nouveau pavé dans la marre en mettant en lumière l’existence d’une douzaine de camps de concentration suédois ouverts dès mars 1940 ; y furent internés, sans jamais être jugés, des milliers de communistes étrangers et nationaux, sans compter tous ceux qui, pour un motif ou un autre, risquaient d’« attenter à la sécurité du pays » [4].
La préparation militaire de la Suisse, de l’emprunt pour la défense nationale à l’organisation du Réduit, avec la menace d’une destruction de l’axe de transit nord-sud en cas d’attaque, a constitué pour les puissances de l’Axe un facteur dissuasif non négligeable. Aucun autre pays neutre d’Europe n’a témoigné d’une telle volonté d’en découdre avec un envahisseur potentiel. La Suède avait une armée bien équipée, mais préféra la laisser dans les casernes afin de contribuer au maintien de la paix. L’armée espagnole devait plutôt être utilisée pour soutenir le IIIe Reich, mais Franco se contenta finalement d’envoyer une division sur le front de l’Est. Le Portugal ne donnait pas précisément l’impression d’un pays prêt à se défendre. Quant à la Turquie, elle ne s’est jamais trouvée dans la situation de devoir démontrer les capacités d’intervention de son important contingent de plus d’un million d’hommes.
La Suisse, insiste Reginbogin, est « l’unique pays parmi les neutres dont on peut affirmer à bon droit qu’il a été effectivement toujours prêt à défendre, dans tous les domaines, sa longue tradition de neutralité ». Lorsqu’on lui reproche d’avoir effectué des transactions sur l’or et les devises avec l’Allemagne, on omet de signaler que les États-Unis avaient bloqué illégalement, en juin 1941, les réserves suisses, et que des entreprises américaines et britanniques, ainsi que des banques et leurs filiales en France, ont contribué, par d’importants investissements, à l’instauration de l’Ordre nouveau en Europe. De surcroît, des banques états-uniennes ont soutenu, même aux États-Unis, divers projets financiers des Allemands, en violation de leurs propres lois. Quant au reproche adressé par Washington d’avoir commercé avec de l’or sans tenir compte de son origine, il concerne en réalité tous les neutres, y compris les États-Unis, où l’habitude d’accepter du métal jaune sans se soucier de sa provenance était solidement ancrée. Au reste, l’existence d’une place financière repose d’abord sur l’achat et la vente d’or et de devises. La Suisse aurait-elle dû, comme certains moralistes semblent l’exiger, tout simplement fermer sa place financière et compromettre ainsi un approvisionnement indispensable à la survie du pays ?
Les armes livrées par la Suisse à l’Allemagne ? Elles ne représentaient que 1 % de la production allemande de matériel de guerre ; l’industrie d’armement allemande aurait pu s’en passer. En revanche, l’exportation de chromite par la Turquie, de tungstène par l’Espagne et le Portugal, de roulements à billes et de minerai de fer par la Suède lui était indispensable. Un arrêt ou une réduction importante de ces livraisons aurait contraint le IIIe Reich, de l’aveu même de son ministre de l’Armement, à mettre beaucoup plus rapidement un terme à la guerre.
La Suisse profiteuse de guerre ? Étant donné les bénéfices considérables réalisés par les autres neutres, mais aussi par les filiales des entreprises américaines, ce grief est absurde. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que les échanges commerciaux avec les puissances de l’Axe ont incité les entreprises suisses à résoudre les problèmes qui se posaient à elles à l’aide de solutions innovatrices, qui engendrèrent à leur tour des processus inédits de production et d’organisation ainsi que le développement de nouveaux produits. « Ces facteurs, liés à l’existence d’unités de production intactes et à une forte présence sur le marché allemand, placèrent indiscutablement l’économie suisse dans une position privilégiée après la guerre ».
Le reproche adressé à la Suisse d’avoir été au courant de l’existence des camps d’extermination lorsqu’elle décida de fermer ses frontières ? On ne trouvera ici probablement jamais de réponse satisfaisant chacun. Toutefois, ajoute Reginbogin, « les pays qui étaient au courant des exterminations en Allemagne, mais qui n’entreprirent rien, tolérant de ce fait d’indicibles souffrances, devraient au moins reconnaître que la Suisse a accueilli des centaines de milliers de personnes et leur a offert un abri sûr ». Dans les Conditions de la survie, nous avons montré comment le Rapport final de la Commission Bergier brouillait les pistes à propos du nombre exact de réfugiés accueillis aux États-Unis de 1939 à 1945, dans le même temps où il réduisait celui des réfugiés accueillis en Suisse. L’historien états-unien constate qu’il en va de même à propos de l’Espagne : la Commission a retenu le chiffre d’environ 100 000 réfugiés ayant transité par son territoire, alors qu’un expert US faisant autorité en la matière mentionne un chiffre de 20 à 30 000 seulement. « Voulait-on montrer en exemple à la Suisse un État dictatorial ? », s’interroge Reginbogin.
L’auteur de Guerre et neutralité est donc fondé à conclure que « la Suisse n’était pas un pays de coupables comme le laisse entendre la Commission Bergier ». Du même coup, il montre l’inanité de l’allégation de M. Bergier selon laquelle une comparaison avec l’étranger n’aurait pas été à l’avantage de la Suisse. Voilà encore un ouvrage qui devrait contribuer à cette réflexion sereine, « indispensable à l’objectivité historique et à l’honneur du pays », que l’historien et ancien président de la Confédération Georges-André Chevallaz appelait de ses vœux dans une lettre d’avril 2002. Et ce n’est sûrement pas le dernier !
titre documents joints

« La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale. Rapport final », par la Commission Indépendante d’Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale, éditions Pendo, Zurich, 2002, 569 pages
(PDF - 2 Mio)
[1] Marc-André Charguéraud, Jean-Philippe Chenaux (dir) et al., « La Suisse, la 2e Guerre mondiale et la crise des années 90 – Les conditions de la survie », Lausanne, Cahiers de la Renaissance vaudoise (CRV), No CXL, 2002.
[2] Parmi les ouvrages en français, on mentionnera surtout ceux du « Groupe de Travail Histoire Vécue », La Suisse face au chantage – Critique des rapports Bergier (Cabédita, 2002) et La Suisse au pilori ? Témoignages et bilan à la suite du rapport Bergier (Cabédita, 2006), ainsi que ceux du Français Marc-André Charguéraud.
[3] Bertrand Müller et Pietro Boschetti, Entretiens avec Jean-François Bergier (Zoé, 2006), p. 128.
[4] Svenska koncentrationläger i tredje rikets skugga (Des camps de concentration suédois à l’ombre du IIIe Reich), éd. Natur och Kultur, cité in : Le Monde, 26 septembre 2008, L’Histoire, novembre 2008.
 Les articles de cet auteur
Les articles de cet auteur












Restez en contact
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Subscribe to weekly newsletter