Au cours des dernières années, les banques occidentales ont stigmatisé l’interventionnisme étatique et plaidé pour une complète privatisation. Érigeant cette idéologie en norme, les banquiers occidentaux sont parvenus, via les institutions financières internationales, à interdire aux États du Sud de contrôler leur secteur financier provoquant les catastrophes économiques que l’on sait. Mais dès que leur activité a été touchée par la crise des subprimes, les mêmes banquiers occidentaux ont réclamé à corps et à cris l’intervention de l’État. Damien Millet et Éric Toussaint dénoncent cette doctrine à géométrie variable.
À maints égards, la crise financière internationale qui s’étend est un splendide révélateur des tromperies et des reniements de la part des promoteurs de la globalisation financière, qu’ils soient dans les conseils d’administration des grandes banques privées ou dans les hautes sphères des États. Durant ces dernières années, le discours dominant proclamait que tout allait pour le mieux sur le front de la dette : grâce à de nouveaux produits, comme la titrisation des créances, le risque se trouvait dispersé entre une multitude d’acteurs. Point de crise en vue, les profits étaient mirobolants et la croissance soutenue.
Aujourd’hui, leur construction s’effondre. Comment pouvait-il en être autrement quand de grandes banques mènent d’énormes opérations hors bilan, construisent un château de cartes avec des crédits douteux et contribuent à créer une bulle spéculative dans le secteur immobilier qui finit par exploser ? Loin de disperser le risque, le système a fait tout le contraire, les grandes banques ayant accumulé les fragilités. Chacune d’elles s’est alors efforcée de passer la patate chaude à sa voisine qui était déjà bien embêtée avec la sienne…
Au lieu de reconnaître leurs erreurs et d’en assumer toutes les conséquences, les grandes banques ont alors fait appel à celui dont elles dénigrent l’action à longueur de temps : l’État. Elles n’ont pas hésité à quémander une action publique forte de la part d’un État qu’elles jugent en général bien trop interventionniste. En effet, les lobbies des grandes banques répètent à l’envi que les pouvoirs publics doivent se plier aux lois du marché qui seuls permettraient d’allouer efficacement les ressources et de fixer les prix à leur juste montant…
Comme de simples subordonnés, les pouvoirs publics des États-Unis et d’Europe se sont exécutés de bonne grâce : on ne refuse rien à des dirigeants de grandes banques qui soutiennent les principaux candidats à l’élection présidentielle et qui évoluent dans les mêmes cercle fermés… Les gouvernants se sont donc empressés d’aller à la rescousse du privé. Au menu : nationalisation de banques en difficulté, échanges de titres dépréciés contre de l’argent frais (pour 200 milliards de dollars aux États-Unis), injection de liquidités, plans de sauvetage, baisse des taux d’intérêts…
En Grande-Bretagne, pays à la pointe de la mondialisation néolibérale, la crise a jeté au tapis la banque Northern Rock en septembre 2007 qui a finalement été nationalisée en février 2008. Une fois l’entreprise remise à flot aux frais de la collectivité, elle sera rendue au privé. De même, aux États-Unis, quand Bear Stearns, 5e banque d’affaires du pays, s’est retrouvée à cours de liquidités le 13 mars dernier, les autorités monétaires ont organisé un montage financier, avec le concours de la banque JP Morgan Chase, qui a ensuite racheté Bear Stearns à prix bradé.
Cette crise prouve clairement que soumettre la gestion de l’économie mondiale à la logique du profit maximum représente un coût énorme pour la société. Les banques ont joué avec l’épargne et les dépôts liquides de centaines de millions d’individus. Leurs errements conduisent à des pertes énormes et à des drames humains, comme ce fut le cas avec la faillite de la multinationale Enron en 2001. Environ 25 000 salariés d’Enron se sont retrouvés avec une retraite dérisoire car le fonds de pension de l’entreprise avait été décapitalisé par les dirigeants qui avaient discrètement vendu leurs actions pour plus d’un milliard de dollars .
Entre Nord et Sud, les ressemblances sont frappantes. Au Sud, la crise de la dette, survenue au début des années 1980, fut provoquée par l’augmentation unilatérale des taux d’intérêt par les États-Unis, entraînant une explosion des remboursements demandés aux pays du tiers-monde que les banques avaient incité à emprunter à taux variables. Dans le même temps, l’effondrement des cours des matières premières les empêchait de pouvoir faire face, les plongeant de manière brutale dans la crise. Le Fonds monétaire international (FMI), téléguidé par les États-Unis et les autres grandes puissances, a alors imposé aux pays en développement des programmes d’ajustement structurel drastiques. Au menu, comme dans les pays du Nord, réduction des budgets sociaux, libéralisation totale et immédiate de l’économie, abandon du contrôle des mouvements de capitaux, ouverture complète des marchés, privatisations massives. Mais contrairement à ce qui se passe aujourd’hui au Nord, l’État du Sud s’est vu interdire de baisser les taux d’intérêts et de fournir des liquidités aux banques, ce qui a provoqué des faillites en cascade et de très fortes récessions. Finalement, comme aujourd’hui, l’État a été contraint de renflouer les banques en difficulté avant de les privatiser souvent au profit des grandes sociétés bancaires nord-américaines ou européennes. Au Mexique, le coût du sauvetage des banques dans la deuxième moitié des années 1990 a représenté 15 % du produit intérieur brut (PIB). En Équateur, une opération identique réalisée en 2000 a coûté 25 % du PIB. Dans tous les cas, la dette publique interne a grimpé fortement car le coût du sauvetage des banques a été supporté par l’État.
La déréglementation économique des dernières décennies a tourné au fiasco. La seule issue valable est un renversement total des priorités : des contraintes très strictes pour les entreprises privées, des investissements publics massifs dans des secteurs permettant de garantir les droits humains fondamentaux et de protéger l’environnement, la récupération par les pouvoirs publics des leviers de décision pour favoriser sans exception l’intérêt général.
Si le train néolibéral continue sa course folle, le crash est garanti. Ceux qui l’ont lancé sur cette voie souhaitent le voir encore accélérer. Preuve la plus récente : après les dernières élections en France, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a déclaré vouloir accélérer ses réformes, alors que les électeurs ont à l’évidence sanctionné les choix actuels. Nul doute qu’un virage économique majeur au niveau international ne pourra survenir sans une forte mobilisation populaire. Quarante ans après mai 68, elle est de plus en plus urgente, pour parvenir enfin à remettre en cause le capitalisme en tant que tel.

 Les articles de cet auteur
Les articles de cet auteur Envoyer un message
Envoyer un message






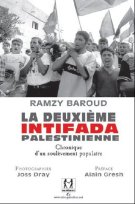
















Restez en contact
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Subscribe to weekly newsletter