Pour contrer l’influence soviétique en Europe, les États-Unis ont constitué, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un réseau d’élites proaméricaines. La CIA a ainsi financé le Congrès pour la liberté de la culture, par lequel sont passés de nombreux intellectuels européens, au premier rang desquels Raymond Aron et Michel Crozier. Chargés, pendant la Guerre froide, d’élaborer une idéologie anticommuniste acceptable en Europe à la fois par la droite conservatrice et par la gauche socialiste et réformiste, ces réseaux ont été réactivés par l’administration Bush. Ils constituent aujourd’hui les relais européens des néo-conservateurs états-uniens.

En 1945, l’Europe, ruinée par la guerre, devient l’enjeu de luttes d’influence entre les États-Unis et l’Union soviétique qui désirent dominer le continent. Afin de contenir la progression des partis communistes en Europe, les gouvernements états-uniens à partir de 1947 mènent une politique interventionniste en prenant appui sur les services secrets, principalement la CIA. Il s’agit d’une part de développer un groupe d’élites pro-états-uniennes par l’intermédiaire du Plan Marshall, relayé en France par le Commissariat au Plan, et d’autre part de financer les intellectuels anticommunistes. Ce projet de diplomatie culturelle prend forme à travers la fondation du Kongress für Kulturelle Freiheit (Congrès pour la liberté de la culture) qui rassemble des personnalités généralement impliquées dans plusieurs opérations d’ingérence états-unienne en Europe (commissions de modernisation, projet de l’Europe fédérale...).
Financé secrètement pendant dix-sept ans par la CIA jusqu’au scandale de 1967, le Congrès pour la liberté de la culture constitue le fer de lance de la diplomatie culturelle états-unienne d’après-guerre. Des intellectuels, écrivains, journalistes, artistes se réunissent afin de réaliser un programme diplomatique dont l’objectif est la défaite idéologique du marxisme. Des revues, des séminaires médiatisés, des programmes de recherche, la création de bourses universitaires, le développement de réseaux de relations informels permettent à l’organisation d’avoir un impact réel dans les milieux universitaires, politiques, artistiques...
Pendant vingt-cinq ans, le Congrès pour la liberté de la culture recrute des intellectuels et fabrique ainsi des réseaux durables d’ingérence en Europe, notamment en France, pays désigné comme l’une des cibles prioritaires de Washington. Ces réseaux ont survécu à la dissolution de l’organisation et ont été réactivés par l’administration Bush. Ils constituent aujourd’hui les relais européens de la diplomatie culturelle décidée par les néo-conservateurs et les néo-libéraux états-uniens, eux-mêmes issus des rangs du Congrès pour la liberté de la culture.
La naissance du Kongress für Kulturelle Freiheit
Le Kongress für Kulturelle Freiheit est né en juin 1950 à Berlin dans la zone d’occupation états-unienne. Le secrétaire général de la réunion, Melvin Lasky, est un journaliste new-yorkais installé en Allemagne depuis la fin de la guerre. Militant de la gauche anti-stalinienne, il devient le rédacteur en chef de Der Monat (Le Mois), revue créée en 1947 avec l’appui de l’Office of Military Government of the United-States, et notamment du général Lucius Clay, « proconsul » de la zone d’occupation états-unienne en Allemagne.

Soutenu par un comité « non-officiel et indépendant », Melvin Lasky tente de rassembler des intellectuels libéraux et socialistes dans une organisation unique, une « internationale » anticommuniste. Le comité de soutien comprend des personnalités comme le philosophe allemand Karl Jaspers, le socialiste Léon Blum, des écrivains comme André Gide et François Mauriac, des universitaires comme Raymond Aron et des intellectuels états-uniens, comme James Burnham et Sidney Hook, principaux théoriciens des New York Intellectuals. Bien que le Congrès regroupe des personnalités du monde entier, y compris du Tiers-Monde, son terrain d’action est exclusivement européen.
Le Congrès pour la liberté de la culture est sous le contrôle des intellectuels états-uniens, pour la plupart des trotskistes new-yorkais, notamment Sol Levitas, animateur du New Leader, et Elliot Cohen, fondateur de Commentary [1], ainsi que des partisans de l’Europe fédérale (Altiero Spinelli, Denis de Rougemont...). Car au-delà de la façade publique, les instances dirigeantes du Congrès ont de multiples connexions avec les réseaux d’ingérence états-uniens de l’après-guerre : l’administration du plan Marshall mais aussi l’American Committee for United Europe (ACUE). Créé durant l’automne 1948 avec l’appui de personnalités gouvernementales (Robert Paterson, secrétaire à la guerre, Paul Hoffman, chef de l’administration du Plan Marshall, Lucius Clay), financé par la CIA, l’ACUE est chargé de favoriser la construction d’une Europe fédérale, conforme aux intérêts de Washington [2].
Cette proximité est même publiquement revendiquée en 1951, lorsqu’Henri Freney, au nom de l’ACUE rencontre officiellement les responsables du Congrès pour la liberté de la culture.
Un manifeste : l’ère des organisateurs de James Burnham
Le Congrès pour la liberté de la culture s’appuie sur un manifeste, l’ouvrage de James Burnham paru en 1941, The managerial revolution [3]. Ce livre met en perspective l’émergence d’une nouvelle idéologie : la rhétorique technocratique. Contre la philosophie de l’Histoire marxiste, qui repose sur la lutte des classes, James Burnham insiste sur l’échec économique et idéologique de l’Union soviétique et annonce l’avènement de « l’ère des managers ». Selon lui, à l’Est comme à l’Ouest, une nouvelle classe dirigeante assure le contrôle de l’État et des entreprises ; cette classe, dite des directeurs, pose d’une façon nouvelle la distinction entre capital et travail. James Burnham récuse donc indirectement les thèses de la philosophie de l’Histoire marxiste (en affirmant que la dichotomie capital/salaire est dépassée) et la perspective d’une victoire des démocraties parlementaires (en prétendant que la décision passe du Parlement aux bureaux). En fait les politiques et les propriétaires traditionnels sont remplacés progressivement par une nouvelle classe de techniciens, de managers.
Avec cette théorie, qui n’est pas sans rappeler le mouvement technocratique des « synarques » dans les années 1930, il se fait le porte-parole d’une vision alternative de l’avenir, « ni de gauche, ni de droite » selon l’expression de Raymond Aron. Et c’est bien l’objectif : enrôler, dans la croisade anticommuniste, les conservateurs, mais surtout les intellectuels de la gauche non-communiste.
Ces thèses sont indissociables de la trajectoire sociale de l’auteur. Fils d’un dirigeant d’une compagnie de chemins de fer, après des études à Oxford et Princeton, James Burnham se fait connaître par la création de la revue Symposium. Abandonnant la philosophie thomiste, il s’intéresse à la traduction du premier ouvrage de Trotski, The history of the russian revolution. Il rencontre Sidney Hook et s’engage dans l’action politique trotskiste avec la fondation en 1937 du Socialist workers party. Après une période de militantisme (il participe à la Quatrième internationale), une polémique avec Trotski sert de point de départ à sa conversion politique. En 1950, il participe ainsi à la création du Congrès pour la Liberté de Culture à Berlin, où il occupe des postes décisionnels importants jusqu’à la fin des années 1960. Pourtant, malgré son engagement dans les réseaux du Congrès, « piégé » par son passé révolutionnaire, James Burnham perd son poste d’universitaire durant la période du maccarthysme.
C’est dans le cadre de ce revirement politique - du trotskisme à la lutte anticommuniste - que James Burnham écrit The managerial revolution, qui constitue un instrument pratique de conversion (pour son auteur mais aussi pour les autres membres du Congrès souvent issus, eux aussi, des milieux trotskistes, notamment les New York Intellectuals [4]).
L’import-export de la rhétorique de la Troisième voie
La rhétorique de la Troisième voie (« la fin des idéologies », « la compétence technique des dirigeants ») fédère dans toute l’Europe de l’ouest des groupes politiques qui s’investissent dans les activités du Congrès, véritable think tank chargé d’élaborer une idéologie anticommuniste acceptable en Europe à la fois par la droite conservatrice et par la gauche socialiste et réformiste. En France, trois courants politiques collaborent avec le Congrès : les militants de l’ex RDR (Rousset et Altman), les intellectuels gaullistes de la revue Liberté de l’esprit tels que Malraux, et les fédéralistes européens.
La doctrine officielle du Congrès a été principalement élaborée par les New York Intellectuals. Leurs publications sont vulgarisées dans les pays européens par des « passeurs » transatlantiques qui assurent des fonctions de relais comme Raymond Aron, qui est à l’origine de la traduction de L’ère des organisateurs, Georges Friedmann qui reprend à son compte les thèses de Daniel Bell, auteur de The end of ideology publié en 1960... En France, les passeurs sont essentiellement des intellectuels relativement marginalisés dans l’espace universitaire ; le Centre d’études sociologiques (CES) constitue l’un des lieux de recrutement du Congrès, dans le sillage du Commissariat au Plan [5]. Les planificateurs attribuent en effet la plupart des crédits de recherche à des économistes et des sociologues qu’ils désirent enrôler afin de légitimer leurs décisions. Edgar Morin, Georges Friedmann, Eric de Dampierre, chercheurs du CES, sont ainsi présents au Congrès anniversaire de 1960.
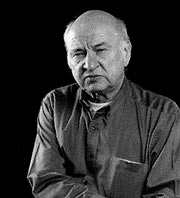
Les intellectuels français du Congrès s’expriment à travers la revue Preuves, équivalent hexagonal de Der Monat. Le recrutement est assuré par le délégué parisien du Congrès, poste détenu par un intellectuel new-yorkais, Daniel Bell qui distribue des crédits de recherche ou des bourses d’études (aux États-Unis) à des jeunes intellectuels européens en échange de leur collaboration à la lutte anticommuniste.
Cette stratégie de recrutement efficace aboutit à la « démarxisation » (selon l’expression utilisée par Domenach, directeur d’Esprit) de certains milieux intellectuels plus ou moins liés au Parti communiste.
Raymond Aron : un intellectuel de la première génération
Raymond Aron, impliqué dans les activités françaises du Congrès jusqu’au scandale de 1967, est l’importateur des thèses des New York Intellectuals. Il fait traduire en 1947 le livre de son ami James Burnham (la première édition de L’ère des organisateurs est préfacée par le socialiste Léon Blum) et organise la diffusion des théories de la Troisième voie.
Après la publication de L’homme contre les tyrans en 1946 et du Grand schismeen 1948, véritables manifestes des conservateurs français, Raymond Aron s’engage dans les réseaux du Congrès dès sa création à Berlin en 1950. Fortement impliqué dans ses structures de décision, au même titre que Michel Collinet et Manès Sperber, Raymond Aron est aussi reconnu comme l’un des théoriciens majeurs de « l’internationale » anticommuniste. En 1955, à la conférence internationale de Milan, il est l’un des cinq orateurs de la séance inaugurale (avec Hugh Gaitskell, Michael Polanyi, Sidney Hook et Friedrich von Hayek [6]). La même année, il publie L’opium des intellectuels, texte inspiré par les idées de James Burnham, dans lequel il dénonce le neutralisme des intellectuels de la gauche non communiste. En 1957, il rédige la préface de La révolution hongroise, Histoire du soulèvement, de Melvin Lasky et François Bondy, deux personnalités majeures du Congrès.
Né en 1905, dans « une famille de la bourgeoisie moyenne du judaïsme français » [7], Raymond Aron, normalien (1924), agrégé (1928), à la veille de la Seconde Guerre mondiale, se destine à une carrière de philosophe. En 1948, malgré le succès des thèses phénoménologico-existentialistes, il n’est pas choisi pour succéder à Albert Bayet à la Sorbonne ; il est contraint d’accepter des postes, relativement peu prestigieux, dans des écoles du pouvoir (ENA, IEP Paris). Parallèlement à cet échec, il acquiert des positions dominantes dans l’espace journalistique (il est l’éditorialiste du Figaro de 1947 à 1977, et participe à L’Express jusqu’à sa mort en 1983) et dans l’espace politique (en 1945, il est membre du gouvernement du général de Gaulle). Cette conversion à « droite » (à la veille de la guerre, Aron est un intellectuel socialiste), à un moment où Sartre domine la scène intellectuelle, est amplifiée par l’engagement dans les réseaux du Congrès et par sa participation active aux commissions de modernisation organisée par l’Association française pour l’accroissement de la productivité, créée en 1950 et qui dépendant du Commissariat au Plan.
La fabrication d’un intellectuel « pro-américain » : la trajectoire politique de Michel Crozier

Michel Crozier, autre acteur clé du dispositif, peut être considéré comme un produit fabriqué par les réseaux du Congrès, qu’il intègre à la fin des années 50 ; son parcours met en perspective les modalités d’instrumentalisation des jeunes intellectuels dans le cadre de la diplomatie culturelle états-unienne.
Au début des années 50, Michel Crozier est un jeune intellectuel connu grâce au succès d’un article publié dans Les temps modernes, la revue dirigée par Sartre. Dans ce texte intitulé « Human engineering », l’auteur s’attaque violemment au New Deal, condamne l’enrôlement des savants et dénonce les méthodes du patronat. L’article est fondamentalement « antiaméricain », « ultragauchiste ». Michel Crozier participe par ailleurs à Socialisme et barbarie, groupe dirigé par Cornelius Castoriadis et fonde La tribune des peuples, une revue tiers-mondiste ; il est soutenu par Daniel Guérin, un trotskiste français.
En 1953, Michel Crozier rompt avec les réseaux du trotskisme français et entre dans le groupe Esprit où il publie un article critiquant l’intelligentsia de gauche. Cette rupture est renforcée par la rencontre, en 1956, de Daniel Bell, délégué parisien du Congrès. Celui-ci obtient pour Crozier une bourse d’études à Stanford. [8]
En 1957, il participe au congrès de Vienne. Son intervention sur le syndicalisme français est publiée dans Preuves.
Intégré dans les réseaux de passeurs, Michel Crozier participe aux commissions de modernisation et devient l’un des idéologues majeurs, avec Raymond Aron, de la Troisième voie française. Il rédige une partie du manifeste du club Jean Moulin [9], réunion de personnalités proches des planificateurs (Georges Suffert, Jean Ripert, Claude Gruson). Ce texte résume fidèlement les lignes directrices de la propagande de la Troisième voie : fin des idéologies, rationalité politique, participation des ouvriers à la gestion de l’entreprise, dévalorisation de l’action parlementaire et promotion des technocrates ...
En 1967, grâce au soutien de Stanley Hoffmann (collaborateur d’Esprit et fondateur du Center for european studies), Michel Crozier est recruté à Harvard. Il rencontre Henry Kissinger et Richard Neustadt, ancien conseiller de Truman, auteur du best-seller The power of presidency. Par l’intermédiaire d’un club organisé par Neustadt, Michel Crozier fréquente Joe Bower, le protégé de MacGeorge Bundy, le chef d’état-major de Kennedy et de Johnson et le président du staff de la Fondation Ford.
Après le scandale de 1967, Michel Crozier, intellectuel « pro-américain » fabriqué par le Congrès, est donc naturellement l’une des personnalités sollicitées pour présider à la reconstruction de l’organisation anticommuniste.
Du Congrès pour la liberté de la culture à l’Association internationale pour la liberté de la culture
En 1967, éclate en effet le scandale du financement occulte du Congrès pour la liberté de la culture, rendu public, en pleine guerre du Vietnam, par une campagne de presse. Dès 1964, le New York Times avait pourtant publié une enquête sur la fondation Fairfield, principal bailleur de fonds officiel du Congrès, et ses liens financiers avec la CIA. À cette époque, l’agence de renseignement états-unienne, par l’intermédiaire de James Angleton [10] tenta de censurer les références au Congrès.
Les dirigeants du Congrès nettoient l’organisation avec l’aide de la fondation Ford qui assume, dés 1966, la totalité du financement. À l’occasion de cette réorganisation, MacGeorge Bundy propose à Raymond Aron de présider la reconstruction du Congrès ; celui-ci refuse en 1967, effrayé par le scandale déclenché en Europe.
Cette année là, un article du magazine Ramparts provoque, malgré une campagne de dénigrement organisée par les services secrets [11], une vague de scandale sans précédent dans l’histoire du Congrès pour la liberté de la culture. Thomas Braden (arrivé à la CIA en 1950, chargé d’organiser la Division internationale d’opposition au communisme) confirme le financement occulte du Congrès dans un article au titre provocateur, « Je suis fier que la CIA soit amorale ».
Après les événements de Mai 68, Jean-Jacques Servan-Schreiber, une des principales personnalités du club Jean Moulin, auteur d’un essai remarqué outre-Atlantique (le best-seller Le défi américain publié en 1967), se rend à Princeton en « quasi-chef d’État [...] accompagné d’une suite qui en laissera pantois plus d’un » [12]. Michel Crozier est chargé de la rédaction des conclusions du séminaire de Princeton pour la presse internationale (le séminaire de Princeton est la première réunion de l’Association internationale).
A partir de 1973, MacGeorge Bundy réduit progressivement les activités de la fondation Ford en Europe. L’Association internationale perd son influence et cesse d’exister (malgré la création d’organisations parallèles) en 1975, date de la signature des accords d’Helsinki.
Au même titre que le Plan Marshall, l’ACUE et le volet militaire du stay-behind, le Congrès pour la liberté de la culture a contribué à installer durablement en Europe, dans le contexte de la Guerre froide, des agents dépendants des crédits états-uniens chargés de concrétiser la diplomatie d’ingérence imaginée à Washington. Une collaboration qui se poursuit aujourd’hui en France par l’intermédiaire de l’aide apportée par les fondations états-uniennes aux intellectuels de la nouvelle Troisième voie française.
Voir la suite de cette enquête de Denis Boneau :
– « La face cachée de la Fondation Saint-Simon »
Sur le même suijet :
– « Quand la CIA finançait les intellectuels italiens », par Federico Roberti
[1] Commentary est la revue quasi-officielle du Congrès pour la liberté de la culture. Elle a été dirigée par Irving Kristol de 1947 à 1952, puis par Norman Podhoretz de 1960 à 1995, qui sont aujourd’hui deux figures clés du mouvement néo-conservateur états-unien. Le fils d’Irving Kristol, William Kristol, dirige actuellement la revue des « néo-cons », le Weekly Standard.
[2] Rémi Kauffer, « La CIA finance la construction européenne », Historia, 27 Février 2003.
[3] James Burnham, The managerial revolution or what is happening in the world now, New York, 1941. L’ère des organisateurs, éditions Calmann-Lévy, 1947.
[4] Joseph Romano, « James Burnham en France : L’import-export de la "révolution managériale" après 1945 », Revue Française de Science Politique, 2003.
[5] Le Commissariat au Plan, créé en 1946 afin d’organiser la distribution des crédits du Plan Marshall (volet économique de la diplomatie états-unienne d’après-guerre), a permis, sous l’impulsion de Jean Monnet, de développer la collaboration entre les hauts fonctionnaires français et les diplomates états-uniens. Etienne Hirsch, successeur de Jean Monnet, a mis en place des instances de « concertation », différents organismes rassemblant des universitaires, des syndicalistes, des hauts fonctionnaires... Les planificateurs ont ainsi fédéré les personnalités liées aux intérêts de Washington et se sont engagés dans une démarche de promotion du « modèle américain » notamment par l’intermédiaire des clubs politiques comme le club Jean Moulin (Georges Suffert, Jean-Jacques Servan-Schreiber), le club Citoyens 60 (Jacques Delors) et le cercle Tocqueville (Claude Bernardin).
[6] En 1947, Hayek participe activement à la fondation de la Société du Mont-Pèlerin. Maison-mère des think tanks néo-libéraux, l’organistation soutenue par l’Institute of Economic Affairs (1955), le Centre for Policy Studies (1974) et l’Adam Smith Institute (1977), regroupe les principaux artisans de la victoire de Margaret Thachter en 1979. Keith Dixon, Les évangélistes du marché, Raisons d’agir, 1998. Voir la note du Réseau Voltaire consacré à la Société du Mont pélerin.
[7] Raymond Aron, Mémoires, 50 ans de réflexion politique, Julliard, 1983.
[8] Michel Crozier, Ma belle époque, Mémoires, Librairie Arthème Fayard , 2002.
[9] Manifeste du Club Jean Moulin, L’État et le citoyen, Seuil, 1961.
[10] James Angleton, membre de la CIA, a participé aux opérations du stay-behind en Europe. Il était le patron X2 du contre-espionnage, et a été chargé, à cette occasion d’entrer en contact le patron du SDECE, les services secrets français, Henri Ribière. Voir « Stay-behind : les réseaux d’ingérence américains ».
[11] Frances Stonor Saunders, Qui mène la danse ? La CIA et la guerre froide culturelle, Éditions Denoël, 2003.
[12] Pierre Grémion, Intelligence de l’anticommunisme, Le Congrès pour la liberté de la culture à Paris, 1950-1975, Arthème Fayard, 1995.
 Les articles de cet auteur
Les articles de cet auteur























Restez en contact
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Subscribe to weekly newsletter