La guerre contre la Syrie est la première conduite durant plus de six ans à l’époque numérique. De très nombreux documents qui auraient dû rester longtemps secrets ont déjà été publiés. Certes, ils l’ont été dans des pays différents de sorte que l’opinion publique internationale n’en a pas conscience, mais ils permettent d’ores et déjà de reconstituer les événements. La publication d’un enregistrement de propos tenus en privé par John Kerry en septembre dernier révèle la politique du secrétariat d’État et contraint tous les observateurs —y compris nous— à revoir leurs analyses précédentes.
La diffusion par The Last Refuge de l’enregistrement complet de la rencontre entre le secrétaire d’État John Kerry et des membres de la Coalition nationale (22 septembre 2016 à la délégation des Pays-Bas aux Nations unies) remet en cause ce que nous avons cru comprendre de la position US vis-à-vis de la Syrie [1].

Premièrement, nous avons cru que si Washington avait lancé l’opération dite du « Printemps arabe » pour renverser les régimes arabes laïques au profit des Frères musulmans, il avait laissé ses alliés entreprendre seuls la Seconde Guerre contre la Syrie à partir de juillet 2012. Ceux-ci poursuivant leurs propres buts (recolonisation pour la France et le Royaume-Uni, conquête du gaz pour le Qatar, expansion du wahhabisme et vengeance de la Guerre civile libanaise pour l’Arabie saoudite, annexion du Nord du pays pour la Turquie sur le modèle chypriote, etc.), l’objectif initial aurait été abandonné. Or, John Kerry affirme dans cet enregistrement que Washington n’a jamais cessé de chercher à renverser la République arabe syrienne, ce qui implique qu’il a contrôlé à chaque étape le travail de ses alliés. De fait, durant les quatre dernières années, les jihadistes ont été commandés, armés et coordonnés par l’Allied LandCom (commandement des Forces terrestres) de l’Otan basé à Izmir (Turquie).

Deuxièmement, John Kerry y reconnaît que Washington ne pouvait pas aller plus loin du fait du Droit international et de la position de la Russie. Comprenons bien : les États-Unis n’ont pas cessé d’outrepasser leur droit. Ils ont détruit l’essentiel des infrastructures pétrolières et gazières du pays, sous prétexte de lutter contre les jihadistes (ce qui est conforme au Droit international), mais sans y être invités par le président el-Assad (ce qui viole le Droit international). Par contre, ils n’ont pas osé déployer leurs troupes au sol et combattre ouvertement la République, comme ils l’ont fait en Corée, au Vietnam et en Irak. Pour cela, ils ont choisi de placer leurs alliés en première ligne (leadership from behind — le leadership par l’arrière) et de soutenir sans grande discrétion des mercenaires, comme au Nicaragua au risque d’être condamnés par la Cour internationale de Justice (le tribunal interne de l’Onu). Washington ne veut pas s’engager dans une guerre contre la Russie. Et celle-ci, qui ne s’était pas opposée à la destruction de la Yougoslavie et de la Libye, s’est relevée et a repoussé la ligne à ne pas franchir. Moscou est en mesure de défendre le Droit par la force si Washington s’engage ouvertement dans une nouvelle guerre de conquête.

Troisièmement, John Kerry y atteste que Washington espérait une victoire de Daesh sur la République. Jusqu’ici, —sur la base du rapport du général Michael Flynn du 12 août 2012 et de l’article de Robin Wright dans le New York Times du 28 septembre 2013— nous avions compris que le Pentagone entendait créer un « Sunnistan » à cheval sur la Syrie et l’Irak afin de couper la route de la soie. Or, il avoue que le plan allait beaucoup plus loin que cela. Probablement, Daesh devait prendre Damas, puis en être chassé par Tel-Aviv (c’est-à-dire se replier sur le « Sunnistan » qui lui avait été attribué). La Syrie aurait alors été partagée au Sud par Israël, à l’Est par Daesh et au Nord par la Turquie.
Ce point permet de comprendre pourquoi Washington a donné l’impression de ne plus rien contrôler, de « laisser faire » ses alliés : en effet, il a engagé la France et le Royaume-Uni dans la guerre en leur faisant croire qu’ils pourraient recoloniser le Levant alors qu’il avait prévu de diviser la Syrie sans eux.

Quatrièmement, en admettant avoir « soutenu » Daesh, John Kerry reconnaît l’avoir armé, ce qui réduit à néant la rhétorique de la « guerre contre le terrorisme ».
– Nous savions depuis l’attentat contre la mosquée al-Askari de Samarra, le 22 février 2006, que Daesh (initialement dénommé « Émirat islamique en Irak ») avait été créé par le directeur national du Renseignement US John Negroponte et le colonel James Steele —sur le modèle de ce qu’ils avaient fait au Honduras— pour mettre fin à la Résistance irakienne et instaurer une guerre civile.
– Nous savions depuis la publication par le quotidien du PKK, Özgür Gündem, du procès-verbal de la réunion de planification tenue à Amman le 1er juin 2014, que les États-Unis avaient organisé l’offensive conjointe de Daesh sur Mossoul et du Gouvernement régional du Kurdistan irakien sur Kirkouk.
– Nous savons maintenant avec certitude que Washington n’a jamais cessé de soutenir Daesh.
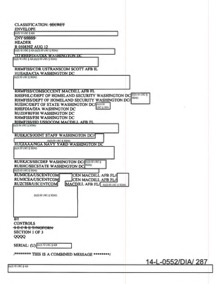
Cinquièmement, nous avions interprété le conflit entre d’un côté le clan Allen/Clinton/Feltman/Petraeus et de l’autre l’administration Obama/Kerry comme portant sur le soutien ou non à Daesh. Il n’en était rien. Les deux camps n’ont eu aucun état d’âme à organiser et à soutenir les jihadistes les plus fanatiques. Leur désaccord porte exclusivement sur le recours à la guerre ouverte —et le conflit avec la Russie qu’elle risque d’impliquer— ou sur le choix de l’action secrète. Seul Flynn —l’actuel conseiller de sécurité de Trump— s’est opposé au jihadisme.
Dans le cas où, dans quelques années, les États-Unis s’effondreraient comme jadis l’URSS, l’enregistrement de John Kerry pourrait être utilisé contre lui et contre Barack Obama devant une juridiction internationale —mais pas devant la Cour pénale internationale qui est aujourd’hui discréditée—. Ayant reconnu les extraits de cette conversation qui en avaient été publiés par le New York Times, il ne pourrait contester l’authenticité du fichier complet. Le soutien que Kerry affiche à Daesh viole plusieurs résolutions des Nations unies et constitue une preuve de sa responsabilité et de celle d’Obama dans les crimes contre l’humanité commis par l’organisation terroriste.
[1] “Absolutely Stunning – Leaked Audio of Secretary Kerry Reveals President Obama Intentionally Allowed Rise of ISIS…”, The Last Refuge (The Conservative Tree House), January 1, 2017.

 Les articles de cet auteur
Les articles de cet auteur Envoyer un message
Envoyer un message






















Restez en contact
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Subscribe to weekly newsletter