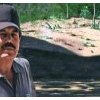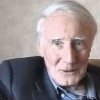Thèmes
Mafias et narcopolitique
Les organisations criminelles contemporaines gèrent les marchés noirs, ceux que les législations déclarent illégaux (drogues, prostitution, immigration clandestine, fausse monnaie, armes, espèces protégées, contrefaçons, organes). Les plus connues sont la Mafia états-unienne, la ’Ndrangheta et la Camorra italiennes, les cartels colombiens, l’Organizatsiya russe, les clans yakuzas japonais et les triades chinoises. Selon les organisations internationales, leur chiffre d’affaire annuel excéderait les 1 000 milliards de dollars US par an.
Paradoxalement, ces organisations sont combattues par les États qui y voient une autorité rivale, mais elles ne peuvent prospérer qu’à l’ombre de ces mêmes États qui, en prohibant des activités économiques, leur accordent de facto un monopole. Il va de soi que, face aux méthodes modernes de surveillance, les organisations criminelles ne peuvent perdurer et s’étendre qu’avec des complicités dans les appareils d’État qu’elles infiltrent et corrompent.
L’obscurité dans laquelle elles se meuvent et leur présence dans les appareils d’État en font des outils parfaits pour des actions politiques et militaires secrètes. Ainsi, les États-Unis utilisèrent les services de Cosa Nostra pour préparer leur débarquement en Sicile et ceux de clans yakuzas pour pacifier le Japon. Sur cette lancée, ils ont armé des cartels colombiens contre les guérillas latino-américaines ou se sont appuyés sur l’Organizatsiya pour accélérer la décomposition de l’ex-URSS. Plus récemment, ils ont armé et salarié des organisations criminelles en Irak pour éradiquer la Résistance.
Les États utilisent également les mafias pour leur narcopolitique. Lors de la guerre de l’opium (1839-1842), le Royaume-Uni organisa la culture du pavot en Inde et imposa sa consommation en Chine. La France, les États-Unis et la Russie s’associèrent à cette politique pour leur propre expansion coloniale. Ce modèle de domination économique est reproduit aujourd’hui à plus grande échelle par les Anglo-Saxons qui exploitent le pavot en Asie centrale et la coca dans les Andes par l’intermédiaire de gouvernements fantoches. Ils utilisent le Pacte de Vienne pour justifier la répression des producteurs concurrents et des insurrections rurales.